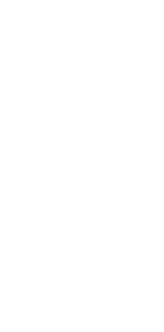« Peut-être qu’une des choses inspirantes pour moi au contact de la peinture – à côté des occasions qu’elle offre de visiter le phénomène esthétique, les circonvolutions et singularités de l’esprit humain, la force des langages, la virtuosité, la détermination inimaginable des artistes, et de couronner cela par des rencontres – c’est cet effet de mûrissement de l’œuvre. C’est un mot qui est à peine métaphysique en l’occurrence parce que le cycle de vie de l’œuvre existe bel et bien. Il est à certains égards comparable à celui du vin dans sa dimension de bonification. Et je trouve que cette idée de mûrissement humanise sa substance. On pense cette donnée inexistante pour des objets prétendument inertes. Ils le sont sur un plan biologique mais soumis qu’ils sont à nos perceptions, ils sont finalement contaminés par notre impermanence. Et puis ils sont emplis de ce que l’artiste a déposé en eux et qui ne nous parvient pas intégralement d’emblée. C’est un faisceau de mouvements convergents. Installations, tableaux ou sculptures sont donc bel et bien matérialisés et relativement stables sur ce plan. À l’exception de quelques dégradations programmées, rien ne permet de parler intrinsèquement de mûrissement. Sauf précisément au sujet de travaux tels que La métamorphose du Christ de Roberto Cuoghi dans lesquels le processus de décomposition fait partie intégrante de l’œuvre. La métamorphose existe à travers nous. L’environnement de l’œuvre est bel et bien de chair, d’esprit et d’idéologies poussées sans cesse par le principe de vitalité, et c’est lui qui est aux commandes de la perception. Le vin évolue biologiquement mais il est aussi éminemment soumis à ce qui nous traverse dans le contexte de sa dégustation. Quelle que soit l’entrée que l’on adopte, la conscience de notre impermanence contamine la création tout entière.
Une œuvre « réelle » prend corps et valeur au fil du temps. Cet argument n’est pas celui du marché, car en dehors de cette logique spéculative qui signifie seulement prendre de la valeur marchande, que comprenons-nous de la vie d’une œuvre, de sa rencontre avec les regards, du dialogue qu’elle entretient avec tous les éléments en présence desquels elle a été placée, et des conséquences sur la vie ? Que comprenons-nous de sa croissance quand elle s’éloigne peu à peu non seulement du regard de son auteur, mais que les témoins de sa venue au monde se raréfient et perdent contact avec ce qu’elle fut de prime abord ? C’est une réflexion que j’aime provoquer parce qu’elle entretient un rapport avec la manière dont nous regardons notre propre mûrissement d’être humain et sa valorisation dans la société. Aussi parce qu’elle amplifie – ce que nous perdons souvent de vue et qui pourtant gouverne nos perceptions plus sûrement que notre volonté – la sensibilité à l’environnement physique et idéologique, la synchronie qu’elle induit, les effets de nos changements profonds, les flux inconscients.
Certains sommeliers ont à gérer des caves aux références nombreuses et acquièrent des vins destinés d’abord au vieillissement avant de l’être à la vente. Je suppose que cette pratique est fréquente dans l’art. Le tableau, le texte, traversent sans aucun doute parfois de longues périodes d’anonymat avant d’arriver à nous, mais nous ne le savons que rarement. Anselm Kiefer a récemment exhumé des tableaux anciens et non montrés, abandonnés en somme, pour les enduire de plomb et faire naître une nouvelle série « Für Andrea Emo ». Le résultat est époustouflant. Peut-être ces œuvres en thébaïde gagnent-elles à leur arrivée, en profondeur d’impact, en puissance, en résonnance, tout comme ces grands vins bus à leur apogée qui laissent à l’être une empreinte mnémonique profonde. Pratiquer un contrepied aux précipitations de rigueur est sans doute un luxe immense. Bien sûr il reste le merveilleux territoire de la performance et l’instantanéité qui est une autre forme de la grâce parce qu’elle affronte le possible ratage avec un aplomb émouvant. Et je ne saurais renoncer à ce domaine de l’art d’ailleurs devenu trop rare. Mais j’aime sentir sur mes murs le temps qu’il faut aux choses. La perception fine de ce mûrissement entre l’artiste et l’œuvre, entre le galeriste et l’artiste, entre l’institution qui acquiert les œuvres et la responsabilité de son geste.
J’aime la peinture pour ses niveaux de lecture qui n’en finissent pas de s’ouvrir en nous épousant. J’aime son bouquet infini qui me nourrit. Je l’aime pour sa vertu silencieuse qui appelle toutes les musiques en temps et en heure, tous les retentissements de valeurs. J’aime la peinture qui emplit nos strates sensibles jusqu’à l’heure où le couchant sur sa toile nous dit qu’il est temps d’ouvrir, d’aérer, de laisser décanter notre propre lymphe pour visiter sa profondeur. Je sais que ce mûrissement existe en constatant chaque matin combien tel tableau est de plus en plus saillant (les paysages d’Andreas Eriksson), tel autre de plus en plus en dialogue avec la lumière (les lucioles de Guillaume Toumanian). Le plus touchant est peut-être de voir l’œuvre, émanation humaine par essence, faire son chemin à l’insu de l’artiste. Chez elle plus que chez vous. En interaction avec les saisons, les bêtes du lieux et l’ensemble exhaustif de ce à quoi elle n’a pourtant jamais été exposée. J’aime le tableau qui donne à mon regard ce que le vin amène à mes capteurs de saveur, l’ivresse élevée et le bain apaisant du mystère. Je l’aime qui guide mon pas dans les dédales quotidiens, les couloirs, qui éclaire les impasses, assombrit bien les abris qui hébergent mes peines, mes leurres. J’absorbe sans manières tous les breuvages qui la célèbrent. Je regarde et je touche secrètement sa robe de matière. J’aime la peinture qui est libre et m’offre de saisir en plein vol ce dont je ne connais pas encore le nom ».